 Qui n'a jamais
entendu parler de l'alcootest, ce fameux test que les forces de l'ordre font subir
aux conducteurs d'automobile soupçonnés d'avoir trop consommé d'alcool ?
Soufflez dans le «ballon», et une réaction d'oxydoréduction se met en
marche ! La chimie, ça existe même après la fête...
Qui n'a jamais
entendu parler de l'alcootest, ce fameux test que les forces de l'ordre font subir
aux conducteurs d'automobile soupçonnés d'avoir trop consommé d'alcool ?
Soufflez dans le «ballon», et une réaction d'oxydoréduction se met en
marche ! La chimie, ça existe même après la fête...
Dans ce document, nous décrirons
les principes biologiques, mécaniques et chimiques qui sont à la base du dosage
de l'alcool dans l'haleine.
Bref historique
L'instrument de mesure du taux
d'alcool, le Breathalyzer®, a été inventé et développé par le docteur
Robert F. Borkenstein, à l'université de l'Indiana, aux États-Unis, en 1958. L'alcootest désigne à la fois l'appareil qui
sert à faire le test et le test lui-même.
On emploie souvent le terme
ivressomètre pour désigner l'alcootest. Selon l'Office de la langue
française, ce terme est impropre, car ce n'est pas l'ivresse que l'on dose, mais
la teneur en alcool de l'air expiré.
Principes biologiques
Le trajet de l'alcool dans l'organisme
L'alcool ingurgité se retrouve dans
l'estomac ; la majeure partie migre vers le petit intestin. Après environ une
demi-heure (selon que l'on est à jeun ou non, car les aliments retardent le
passage de l'alcool de l'estomac au petit intestin), l'alcool passe dans le
sang. Il est ensuite dirigé vers le foie où près de 90 % sera dégradé à raison
de 0,1 g d'alcool par kg de masse corporelle et par heure (environ une consommation). Rien ne peut augmenter l'élimination de
l'alcool sanguin: danser, marcher, prendre une douche, un café, un jus de tomate
n'aident absolument pas à dégriser plus rapidement. Seul le temps permettra au
foie de dégrader tout l'alcool consommé.
L'alcool non métabolisé quitte le
foie pour aller au coeur. Le sang veineux est alors propulsé vers les poumons où
il sera oxygéné. L'oxygène de l'air passe dans le sang tandis que le dioxyde de
carbone et l'alcool sont expirés dans l'air, d'où la présence de l'alcool dans
l'haleine d'une personne qui a bu des boissons alcooliques.
Les reins (urine), la peau
(transpiration) et les poumons (respiration) éliminent entre 5 et 10 % de
l'alcool en circulation.
L'éthanol est soluble dans l'eau et les lipides (corps gras). Comme la
membrane des cellules nerveuses (neurones) est constituée de 75 % à 80 % de
lipides (pour la plupart des autres types de cellules, ce pourcentage est en
moyenne deux fois moindre), l'alcool sanguin influence grandement le cerveau et
le système nerveux central. En effet, la présence d'éthanol dans le sang
provoque une déformation de la membrane lipidique des neurones (fluidisation de
la membrane). Cette altération amène une chute de l'efficacité de la
transmission de l'influx nerveux dans l'axone. Il s'en suit une diminution des
facultés chez l'individu.
La relation entre le taux d'alcool dans le sang et celui dans l'haleine
On peut relier la concentration en
alcool dans l'haleine d'une personne à celle qui est contenue dans le sang de
l'organisme en appliquant la Loi de Henry (William Henry, physicien et chimiste).
On trouve alors autant d'alcool dans 2 100 cm3 d'air alvéolaire
expiré que dans un cm3 de sang. En d'autres termes, l'air
alvéolaire est 2 100 fois moins concentré en alcool que le sang. Au Canada,
le taux maximal d'alcoolémie permis est de 80 mg d'alcool éthylique dans
100 cm3 de sang (80 mg %), communément appelé point zéro huit
(.08).
Principes mécaniques de
l'instrument de mesure
 L'alcootest n'est
rien de plus qu'un colorimètre muni d'une cellule photoélectrique qui donne une
mesure précise de l'alcoolémie. Il y a comparaison entre la couleur jaune orangé
d'une ampoule témoin d'une solution de dichromate de potassium et l'ampoule de
la même solution dans laquelle a barboté une quantité précise d'air alvéolaire
(ampoule d'essai). La lumière transmise par l'ampoule d'essai est convertie, à
l'aide d'une cellule photoélectrique, en courant dont l'intensité peut être lue
directement sur un cadran de lecture qui a été préalablement étalonné pour
donner une lecture directe de l'alcoolémie.
L'alcootest n'est
rien de plus qu'un colorimètre muni d'une cellule photoélectrique qui donne une
mesure précise de l'alcoolémie. Il y a comparaison entre la couleur jaune orangé
d'une ampoule témoin d'une solution de dichromate de potassium et l'ampoule de
la même solution dans laquelle a barboté une quantité précise d'air alvéolaire
(ampoule d'essai). La lumière transmise par l'ampoule d'essai est convertie, à
l'aide d'une cellule photoélectrique, en courant dont l'intensité peut être lue
directement sur un cadran de lecture qui a été préalablement étalonné pour
donner une lecture directe de l'alcoolémie.
Principe de base du fonctionnement de l'appareil
Le Breathalyzer® a été
conçu pour recueillir la dernière portion d'air d'une expiration prolongée. On
veut seulement l'air alvéolaire car l'air des voies respiratoires supérieures ne
participe pas aux échanges gazeux dans les poumons. En soufflant dans le tube de
l'alcootest, l'air expiré par une personne pénètre dans un cylindre muni d'un
piston mobile qui se déplace verticalement. Le cylindre possède une entrée d'air
à sa base et deux trous de ventilation à sa partie supérieure. La pression
exercée par l'air expiré de la personne fait monter le piston vers le haut du
cylindre de façon à ce que la première partie de cet air (air des voies
respiratoires supérieures) soit évacuée par les trous de ventilation.
Lorsque la personne cesse
d'expirer, le piston est entraîné par la force de gravitation vers le bas du
cylindre et recouvre les trous de ventilation. Le piston est alors arrêté par
des aimants qui le maintiennent en place. Le cylindre, en acier inoxydable, est
maintenu à une température constante de 50 °C afin de prévenir la condensation
de la vapeur d'eau. Le volume d'air expiré contenu dans le cylindre est de 55,2
ml à 50 °C.
Lorsque le technicien est prêt à
faire le test, il déclenche un mécanisme qui désaligne les aimants de leurs
pôles. Le piston n'étant plus retenu reprend sa course vers le bas et force
l'air à sortir du cylindre et à s'introduire dans une ampoule qui contient du
dichromate de potassium (K2Cr2O7), de l'acide sulfurique
(H2SO4) concentré et du nitrate d'argent
(AgNO3).
Principes chimiques
L'alcool éthylique contenu dans
l'air alvéolaire réagit avec le dichromate de potassium selon la réaction
d'oxydoréduction suivante (équation non balancée):
|
CH3CH2OH (l) + K2Cr2O7(aq)
+ H2SO4(aq)
 CH3COOH(aq) + Cr2(SO4)3(aq)
+ K2SO4(aq) + 11H2O (l) CH3COOH(aq) + Cr2(SO4)3(aq)
+ K2SO4(aq) + 11H2O (l)
|
Dans cette réaction, les ions
Cr6+ (aq) de l'ion dicromate Cr2O72-
(aq) sont réduits par l'éthanol (CH3CH2OH) en ions
Cr3+ (aq). La réaction est terminée lorsque la couleur jaune orangé
de la solution a viré au bleu-vert, ce qui signifie que tout le dichromate de
potassium a réagi avec l'éthanol. Le nitrate d'argent (AgNO3) joue le
rôle de catalyseur. Il accélère la réaction et permet
l'oxydation complète de l'éthanol en 90 secondes. L'acide sulfurique permet de
capter et de retenir les vapeurs d'eau contenues dans l'échantillon
d'haleine.
La décoloration du réactif est
proportionnelle à la quantité d'alcool oxydé.
Note: L'ampoule d'essai contient
suffisamment de réactifs pour oxyder un échantillon d'air dont la concentration
en alcool est de 700 mg %.
Calcul de l'alcoolémie
Tout
d'abord, il faut tenir compte que la température de l'haleine est de 34 °C. Par
conséquent, le volume d'air contenu dans le cylindre, qui est de 55,2 ml à 50
°C, doit être converti à 34 °C. En appliquant la première loi de Charles et
Gay-Lussac, on peut
calculer ce volume. Si on connaît, à l'aide de l'équation balancée, le
nombre de moles de dichromate de potassium contenues dans l'ampoule (3 ml), il
sera possible de calculer le nombre de moles d'éthanol contenues dans
l'échantillon d'air alvéolaire. On reconnaît que la précision des résultats est
de plus ou moins 10 %. Ils constituent toutefois une évaluation valable de la
détérioration du système nerveux central par l'alcool.
Facteurs d'erreurs
- La qualité de l'échantillon
recueilli
- Si l'air à analyser provient
d'un souffle trop court, il sera constitué d'un mélange d'air alvéolaire et
d'air des voies respiratoires. Ce dernier ne participe pas aux échanges
gazeux. L'alcoolémie sera alors faussement abaissée.
- Le rapport de distribution air
alvéolaire - sang
- Selon des études récentes, le
rapport serait plutôt de 2 300 : 1 au lieu de 2 100 : 1, ce qui entraîne en
moyenne une sous-estimation de l'alcoolémie de l'ordre de 10 %.

Alcootests personnels
On peut louer ou acheter des
alcootests. Ces appareils n'ont probablement pas la précision des appareils
utilisés par les corps policiers, mais ils peuvent au moins donner une bonne
idée de l'état des personnes qui ont consommé quelques verres. Ils fonctionnent
sur les mêmes principes chimiques que ceux utilisés par les policiers.

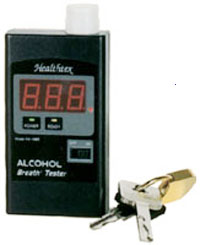
 |
Des bars mettent même à la
disposition de leurs clients un appareil qui dose le taux d'alcool dans
l'haleine (Alco Bar Chec). |
 |
On a aussi conçu un démarreur
éthylométrique. C'est un appareil qui se branche sur une voiture et dans lequel
on doit souffler - comme un alcootest - avant de mettre le contact. S'il y a
présence d'alcool dans l'haleine, la voiture ne démarre pas et un
microprocesseur mémorise la tentative infructueuse du conducteur.
Alcootests jetables
On peut
acheter des alcootests sous forme de petits tubes dans lesquels on peut voir des
cristaux
jaunes. Après avoir soufflé
dans le tube, les cristaux changeront de couleur et deviendront verts en présence d'un taux d'alcool plus grand
que 80 mg %.
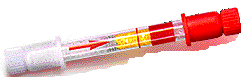
Il existe aussi des sachets. Quinze
minutes après avoir pris un dernier verre d'alcool, on n'a qu'à ouvrir le sachet
qui contient une bandelette en plastique munie d'un bout réactif qu'on place sur
la langue afin qu'il touche à la salive. Deux minutes plus tard, la présence
d'alcool dans le sang est signalée par un changement distinct de la couleur du
bout réactif qui est ensuite comparé avec une carte témoin afin de déterminer le
degré d'alcool. Il est alors facile de constater si le sang contient plus
d'alcool que la limite permise par la loi lorsqu'on prend le volant.

Démonstration en
laboratoire
 Matériel
Matériel
2 éprouvettes
Compte-gouttes
Support à
éprouvettes
K2Cr2O7 0,1
M
H2SO4 6 M
Éthanol 95 %
Manipulations
1. Dans 2 éprouvettes, verser 20 ml de
K2Cr2O7 0,1 M et 10 ml de
H2SO4 6 M. Une éprouvette servira de témoin et l'autre de
tube d'essai.
2. Dans le tube d'essai, déposer des gouttes d'éthanol jusqu'à ce que
l'échantillon change de couleur par rapport à la couleur du témoin.
Note: À l'aide d'un spectrophotomètre, on pourrait comparer exactement le
changement de couleur entre le jaune-orangé de l'éprouvette témoin et le
bleu-verdâtre de l'éprouvette d'essai. Une courbe d'étalonnage déterminerait la
concentration en alcool de l'échantillon.
Vous pouvez aussi consulter l'article Alcohol
Breathalyzer Demonstration.

Glossaire
Consommation
- On peut traduire le mot
consommation par 350 ml de bière (une bouteille), 43 ml de spiritueux à 40 %
(rhum, scotch, gin, etc.), 150 ml de vin, etc. À poids égal, le corps d'une
femme contient moins de liquide que celui d'un homme, ce qui fait que le même
verre produira une concentration d'alcool dans le sang plus élevée pour une
femme que pour un homme.
Alcoolémie
- Le nombre de mg d'éthanol
présent dans 100 ml de sang.
Catalyseur
- Substance qui a la propriété de
modifier la vitesse d'une réaction chimique. Se retrouve intacte à la fin de
la réaction.
Première loi de Charles et Gay-Lussac
- À pression constante, le volume
d'un gaz est directement proportionnel à la température exprimée en Kelvin.
V / T = k
V / T = V1 / T1
Loi de
Henry
- À température donnée, la
quantité des gaz dissous à saturation dans un liquide est proportionnelle à la
pression du gaz au-dessus de ce liquide.

Bibliographie
Livres
DOROZYNSKI, A., et M. VOLNAY.
Pratique de l'alcool et de l'alcootest, Paris, Éditions Bordas, 1978, 95
p.
EID, Henri. La chimie par le
concret, Montréal, Lidec, 1993, 2e édition, 475 p.
Revue
ROBITAILLE, Jean-Pierre. «Le
Breathalyzer de Borkenstein - l'alcootest utilisé au Québec depuis 20 ans»,
Chimiste, vol. 5,
no 6, février 1991.
Disques optiques
compacts
ARCAND, Denis. (1996, Juillet).
«Le démarreur éthylométrique bientôt en usage au Québec?». La Presse
[CD-ROM]. Actualité/Québec, CEDROM-SNi, Version 3.36, Outremont, Juin
1996.
CHARBONNEAU, Jean-Paul. (1996,
Décembre). «Sobritest vous dit si vous êtes aptes à prendre le volant». La
Presse [CD-ROM]. Actualité/Québec, CEDROM-SNi, Version 3.36, Outremont, Juin
1996.
THIBAUDEAU, Carole. (1994,
Décembre). «Comment boire sans se rendre malade». La Presse [CD-ROM].
Actualité/Québec, CEDROM-SNi, Version 3.36, Outremont, Juin 1996.
Documents dans
W3
ALCOTEST QUÉBEC INC. (Page
consultée le 6 décembre 2004). Alcotest
Québec, [En ligne]. Adresse
URL: http://www.alcotestquebec.com/produits.html
HEAD, William C. (Page consultée le 6 décembre 2004).
Breath Testing Information, [En ligne]. Adresse URL:
http://www.drunkdrivingdefense.com/general/breath-testing-information.htm
GORMLEY, Patrick. (Page consultée
le 6 décembre 2004). Alcohol Breathalyzer
Demonstration, [En
ligne]. Adresse URL:
http://chem.lapeer.org/Chem1Docs/Breathalyzer.html
SCHOKNECHT G., et B. STOCK. (Page
consultée le 6 décembre 2004). The Technical Concept for Evidential
Breath Testing in Germany, [En ligne]. Adresse URL:
http://raru.adelaide.edu.au/T95/paper/s5p6.html
ST-ONGE, André. (Page consultée
le 6 décembre 2004). Chimie 534 - Effet
de la pression, Facteur modifiant le volume d'un gaz: la
température, [En
ligne]. Adresse URL:
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/chimie534/tempa.htm
ST-ONGE, André. (Page consultée le 6 décembre 2004). Chimie 534 - La température Kelvin, Effet de la température sur
la pression d'un gaz, [En ligne]. Adresse URL:
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/chimisterie/chimie534/Charles.htm

La modération a bien meilleur
goût...
 Qui n'a jamais
entendu parler de l'alcootest, ce fameux test que les forces de l'ordre font subir
aux conducteurs d'automobile soupçonnés d'avoir trop consommé d'alcool ?
Soufflez dans le «ballon», et une réaction d'oxydoréduction se met en
marche ! La chimie, ça existe même après la fête...
Qui n'a jamais
entendu parler de l'alcootest, ce fameux test que les forces de l'ordre font subir
aux conducteurs d'automobile soupçonnés d'avoir trop consommé d'alcool ?
Soufflez dans le «ballon», et une réaction d'oxydoréduction se met en
marche ! La chimie, ça existe même après la fête... L'alcootest n'est
rien de plus qu'un colorimètre muni d'une cellule photoélectrique qui donne une
mesure précise de l'alcoolémie. Il y a comparaison entre la couleur jaune orangé
d'une ampoule témoin d'une solution de dichromate de potassium et l'ampoule de
la même solution dans laquelle a barboté une quantité précise d'air alvéolaire
(ampoule d'essai). La lumière transmise par l'ampoule d'essai est convertie, à
l'aide d'une cellule photoélectrique, en courant dont l'intensité peut être lue
directement sur un cadran de lecture qui a été préalablement étalonné pour
donner une lecture directe de l'alcoolémie.
L'alcootest n'est
rien de plus qu'un colorimètre muni d'une cellule photoélectrique qui donne une
mesure précise de l'alcoolémie. Il y a comparaison entre la couleur jaune orangé
d'une ampoule témoin d'une solution de dichromate de potassium et l'ampoule de
la même solution dans laquelle a barboté une quantité précise d'air alvéolaire
(ampoule d'essai). La lumière transmise par l'ampoule d'essai est convertie, à
l'aide d'une cellule photoélectrique, en courant dont l'intensité peut être lue
directement sur un cadran de lecture qui a été préalablement étalonné pour
donner une lecture directe de l'alcoolémie.

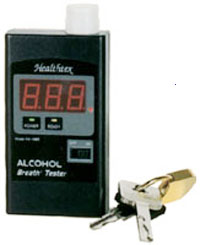


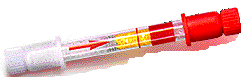
 Matériel
Matériel
