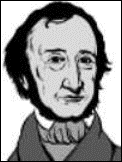
Réaumur,
Fahrenheit, Celsius et les autres
Comment mesurer une température ?
Si la question paraît simple de nos jours, elle a posé problème de l’Antiquité à la fin du XVIIIème siècle. Le mot « thermomètre » apparaît pour la première fois en 1624 dans les Récréations mathématiques de Jean Leurechon (1593-1670), où est représenté également un « thermoscope » de Héron d’Alexandrie datant du Ier siècle avant J-C.
Le secret d’un thermomètre réside dans le fait qu’un liquide se dilate régulièrement et de façon mesurable lorsque sa température augmente. Cette observation fut exploitée en 1654 par le grand-duc de Toscane, Ferdinand II de Médicis (1610-1670), qui créa un thermomètre se présentant sous la forme d’un réservoir surmonté d’un tube contenant un liquide (une solution aqueuse d’alcool) et sur lequel des traces d’émail séparaient le positions extrêmes du liquide en cinquante graduations. Par la suite, les graduations furent inscrites sur une planche de bois maintenant le tube.
En 1665, Robert Hooke (1635-1703) choisit comme point fixe pour son thermomètre à alcool le point de solidification de l’eau. Malheureusement, son échelle de graduation trop compliquée fut abandonnée. Néanmoins, l’idée de construire une échelle autour de deux points fixes fit lentement son chemin et l’italien Bartolo proposa de considérer les températures de solidification et d’ébullition de l’eau, puisque Guillaume Amontons venait de montrer que cette dernière était constante. Notons la variété des points proposés : point de fusion du beurre, d’un mélange glace-sel, température d’une cave au moment le plus froid de l’hiver …
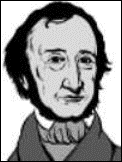 |
En 1708, Daniel Fahrenheit (1686-1736), jeune physicien allemand, proposa de fixer à 0 degré la température la plus basse atteinte par le mélange eau-sel, et à 96 degrés la température moyenne du corps humain. Il fut le premier à fabriquer un thermomètre à mercure, corps liquide dont la dilatation est moins grande que celle de l’alcool pour un même écart de température, mais dont la composition est fixe. |
| En 1730, René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) formula des règles de construction d’un thermomètre à alcool pour lequel l’eau gèle à 0 degré et bout à 80 degrés. Le bien-fondé des deux points fut établi en 1744 lorsqu’il apprend avec enthousiasme qu’au Pérou la neige fond aussi au degré 0 de son thermomètre. | 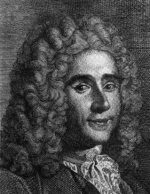 |
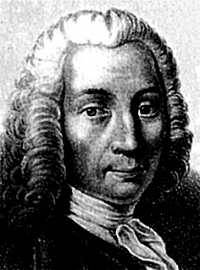 |
En 1741, Anders Celsius (1701-1744), physicien danois, propose l’échelle centigrade et fixe à 0 degré le point d’ébullition de l’eau et à 100 celui de sa solidification. Le thermomètre est à mercure. L’échelle sera inversée par la suite et adoptée comme échelle légale en 1794. |
La relation entre la température et la vitesse des molécules fut longue à germer. L’échelle absolue de température ne s’est imposée que presque 1 siècle après l’échelle Celsius, et ce grâce aux illustres efforts de Joule, Clausius et Kelvin. Cette échelle est aujourd’hui utilisée par le monde scientifique même si l’échelle Kelvin lui est préférée (mais ne résulte que d’une simple décalage de l’échelle Celsius). La majorité de la planète a adopté l’échelle Celsius, et les anglo-saxons l’échelle Fahrenheit.
(°F)
= 9/5 x (°C)
+ 32